 |
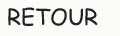 |
|---|
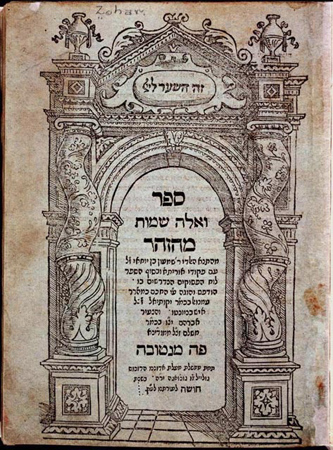
DESCRIPTIF PAR CHARLES MOPSIK
Les
conséquences sociétales de la rédaction du Zohar.
L'exposé
qui suit fait suite à une présentation précédente de la structure littéraire du
Zohar.
Que nous
apprend l'analyse formelle de l'ouvrage sur les conditions sociales de sa
rédaction et de sa réception immédiate?
Pourquoi
le Zohar a-t-il été écrit? Quelles sont les déterminations historiques et
sociales qui président à sa rédaction?
Qu'elle a
été le moteur de la rédaction d'un livre comme le Zohar dans la société juive
opprimée de l'Espagne de la Reconquista ? Et cela, en dehors même des questions
de l'influence éventuelle du christianisme comme doctrine ou système de
représentation.
Champ de
production: l'espace social limité et relativement clos à l'intérieur duquel se
déploie l'enjeu idéologique de la production des œuvres littéraires et
artistiques.
Ecrit pour
être lu cela veut dire: écrit en fonction des lecteurs possibles. Et ces
derniers ne sont pas seulement une vague postérité, mais des agents sociaux -
dominants ou dominés - qui défendent leurs intérêts propres.
Le Zohar
est-il une œuvre conservatrice ou révolutionnaire ? Dans l'historiographie
contemporaine, G. Scholem tend plutôt à voir le Zohar comme révolutionnaire,
tandis que M. Idel y voit une œuvre très conservatrice. Nous tentons d'élaborer
une synthèse.
Abraham
Aboulafia, né à Saragosse en 1240. Il
fut excommunié par R. Salomon ben Abraham ibn Adret après une violente attaque
contre son enseignement. Il dut quitter l'Espagne pour la Sicile et mena une
vie errante.
Il faut
rectifier: il s'agit de R. Salomon ben Abraham ibn Adret, un disciple
barcelonais de Nahmanide, qui était lui aussi un "cabaliste", mais
d'une école opposée à la divulgation de la cabale.
On trouve
bien quelques critiques à l'encontre de l'école théosophique du Zohar, surtout
de la part des tenants de l'école de Nahmanide, comme l'auteur inconnu du
Ma'arekhet ha-Elohut, mais elles n'ont eu qu'une assez faible portée.
Commentaire
sur le Cantique des Cantiques de Isaac ibn Abi Sehulah: édité par A. Green,
dans Jerusalem Studies in Jewish Thought, vol. 6, 3-4, 1987, p. 393 et
suivantes.
Rappelons
qu'au Moyen Âge, il était fréquent de voir circuler des écrits de type
midrachique (apocalyptiques ou narratifs) attribués à des maîtres anciens, sans
que la question de leur autorité ou de leur attribution soit clairement posée.
Le Zohar a
été accepté sans réticence par la majorité des cabalistes espagnols comme une
œuvre de grande portée. Son attribution à R. Siméon ben Yohaï n'était pas le
point le plus controversé.
Le Zohar a
permis aux cabalistes de faire valoir plus aisément leur doctrine comme étant
une "tradition" autorisée.
Même les
nouvelles interprétations des cabalistes ont pu fusionner grâce au Zohar avec
la "tradition". La notion de "tradition" est une composante
essentielle de toute religion, ce que Danièle Hervieu-Léger montre dans La
religions pour mémoire, Paris, 1991.
Jacob ben
Chéchet, Ha-Emounah veha-Bitahon, dans Kitvey Ramban, t. 2, Mossad ha-Rav Kook,
éd. Chavel, Jérusalem, 1974.
Le Zohar
se réfère constamment au Talmud et au Midrach rabbinique, mais il fait aussi
des emprunts plus discrets à des exégètes médiévaux comme Rachi ou Abraham Ibn
Ezra. Il emprunte aussi à Maïmonide.
Milin
hadetin 'atiqin : anciennes nouvelles paroles. Dans sa Haqdamah (introduction
ou préliminaire, Zohar I, 1a-14b), le Zohar se livre à une apologie des
"paroles nouvelles" prononcées par les exégètes, qui "s'élèvent
au ciel, créant des cieux nouveaux..."
La
querelle entre les "modernes" et les "anciens" se pose en
des termes particuliers dans le Zohar, où on retrouve pourtant les traits
habituels à ce type de conflit universel entre générations.
Par
l'expression "matnita dilan", le Zohar se réfère à une
"Michnah" (enseignement) de nature ésotérique transmise par les
cabalistes.
Les
cabalistes se posent à la fois comme des
héritiers et des pionniers, des transmetteurs fidèles et des novateurs
audacieux. Cela pourrait être un trait caractéristique de la religiosité
mystique.
Les cabalistes
de l'Ecole du Zohar avaient conscience de n'avoir entre les mains qu'une partie
seulement des secrets de la Torah. D'où la mission qu'ils se donnaient de
reconstituer ces derniers par leurs expériences mystiques, ce qui en retour les
validaient.
R. Hayyim
Vital dans son livre 'Cha'arey Qedouchah", chap. 4 (édité Jérusalem en
1988), décrit la technique d'appel des âmes des tannaïm.
Au moyen
de ces techniques mystiques, ce sont les maîtres des siècles passés qui
continuent à délivrer un enseignement nouveau pour le présent.
Le Zohar
et d'autres cabalistes du XIIIe siècle ont joué sur le double sens du mot
Michnah pour dire faire fusionner deux choses distinctes: un enseignement
nouveau et le corps doctrinal canonique ancien.
Prestige
d'auteur et autorité de transmetteurs: tels sont les deux principaux succès
personnels des cabalistes du XIIIe siècle.
Les
enseignements des maîtres anciens sont présentés dans le Zohar comme des
savoirs nouveaux.
"Les
compagnons ont commenté ce verset, mais voilà son secret..." tel est le
prologue le plus fréquent précédent de nombreux développements dans le Zohar.
L'enseignement
classique n'est pas présenté comme étant obsolète, mais comme étant secondaire,
périphérique, face à l'enseignement ésotérique affiché comme étant le noyau
fondamental, la vérité intime du texte biblique.
Les
interprétations cabalistiques du Zohar sont présentées comme devant être
considérées comme le savoir le plus éminent, qui doit dominer le champ de
l'étude religieuse.
La
réception sociale et la diffusion du Zohar attestent du succès de la stratégie
de son auteur, malgré son caractère paradoxale et risquée.
Dans une
liste publiée par G. Scholem il y a une trentaine d'années, plus de 80
commentaires suivis du Zohar sont mentionnés. Il existe aussi d'autres
commentaires dans des œuvres séparées, mais ils n'ont pas ce caractère suivi.
Le Zohar
n'est pas un commentaire de plus sur la Torah, c'est une forme nouvelle, une
façon nouvelle d'interpréter la Torah et de s'y rapporter.
La
tentative revivaliste du judaïsme qui est celle du Zohar s'est étendue au-delà
de son époque et poursuit son projet jusqu'à nos jours, comme en témoigne
l'émergence fréquente de mouvements mystiques fondés sur le Zohar, comme les
"Centres de la Kabbale".
La
semikhah est le nom donné à l'ordination des maîtres à la fin de l'Antiquité.
Elle n'était plus pratiquée depuis le IVe siècle, où elle avait été interdite
par l'autorité romaine.
R. Joseph
Caro (1488-1575), R. Moïse Cordorévo (1522-1570), ils vivaient à Safed et
étaient d'origine espagnole.
Malgré son
côté "révolutionnaire" par ses aspirations messianiques et
prophétiques nettement affirmées, Abraham Aboulafia et son enseignement ne
parviendront pas à bouleverser durablement le judaïsme.
Pour
appréhender le champ social dans lequel l'auteur du Zohar vivait il faut
étudier aussi les personnages principaux du Zohar - et les figures mineures
également.
Les héros
du Zohar ne sont pas des autorités rabbiniques dirigeant ou dominant des
institutions synagogales ou communautaires.
R. Judah
Ha-Nassi (le Prince), qui vivait au IIe siècle, est une figure secondaire dans
le Zohar, alors qu'il est une figure centrale dans la tradition rabbinique du
Talmud.
Les
Tannaïm apparaissent dans le Zohar comme des enseignants itinérants, pauvres et
humbles, jamais comme des seigneurs, gardiens de la Loi.
Le Zohar
accorde aussi une place importante dans l'échelle de la connaissance des
mystères de la Torah à des personnages très modestes: conducteurs d'ânes,
enfants, aubergistes, etc. Moïse de Léon voulait explicitement
"démocratiser" les secrets de la Torah.
Le Zohar
s'adresse à tout le monde, il veut révéler les secrets de la Torah à l'ensemble
du peuple, les arrachant ainsi à l'élite sociale des intellectuels et des
autorités rabbiniques.
Le Zohar
met au premier plan l'idée du salut des humbles et ne le réserve pas - comme
les philosophes juifs - à quelques savants.
L'avarice,
surtout celle des riches, est l'un des
défauts les plus critiqués par le Zohar.
Pour le
Zohar, donner la charité revient à "faire Dieu". Voir III, 113a. Voir
notre ouvrage, Les grands textes de la cabale, les rites qui font Dieu,
Lagrasse, 1993, p. 560 et suiv.
Le Zohar
engage une lutte constante contre le désespoir qui est pour lui la clé de
l'impiété.
Pourquoi
le Zohar adopte-t-il un style énigmatique pour s'adresser aux "gens du
peuple"?
Quel
rapport existe-t-il entre une formule ésotérique et un slogan ?